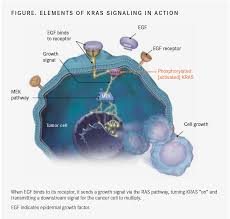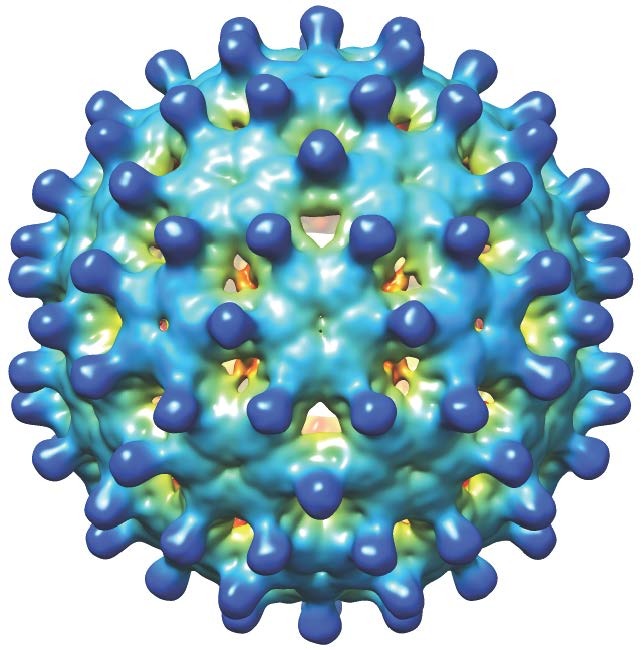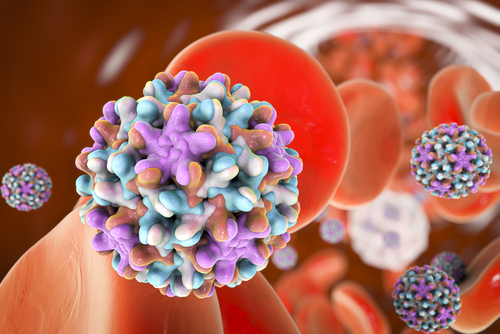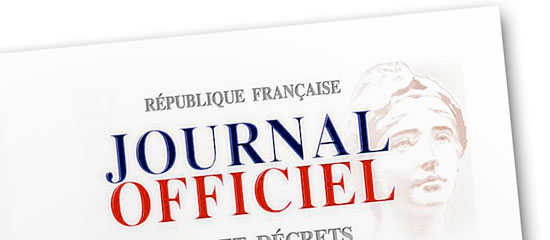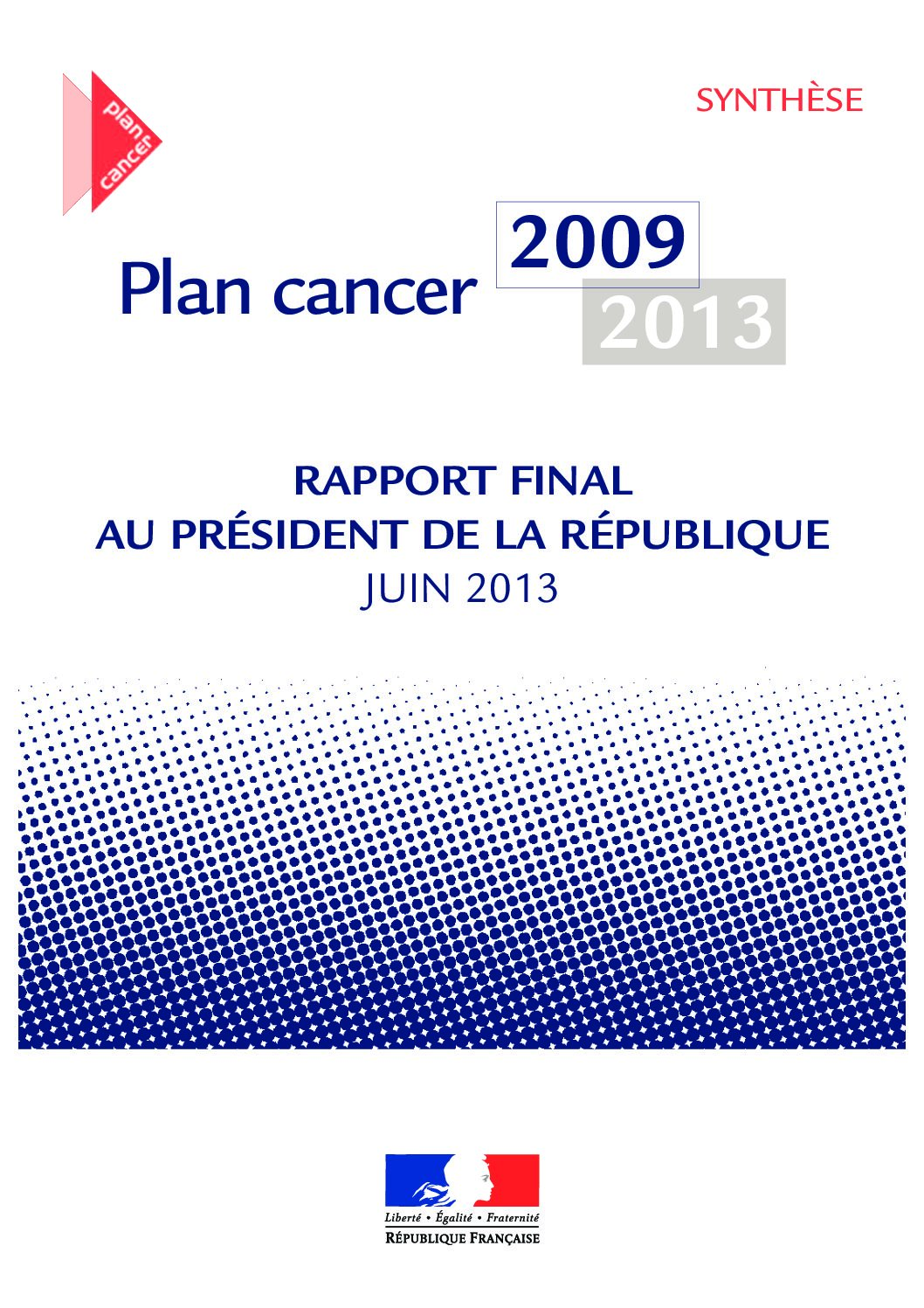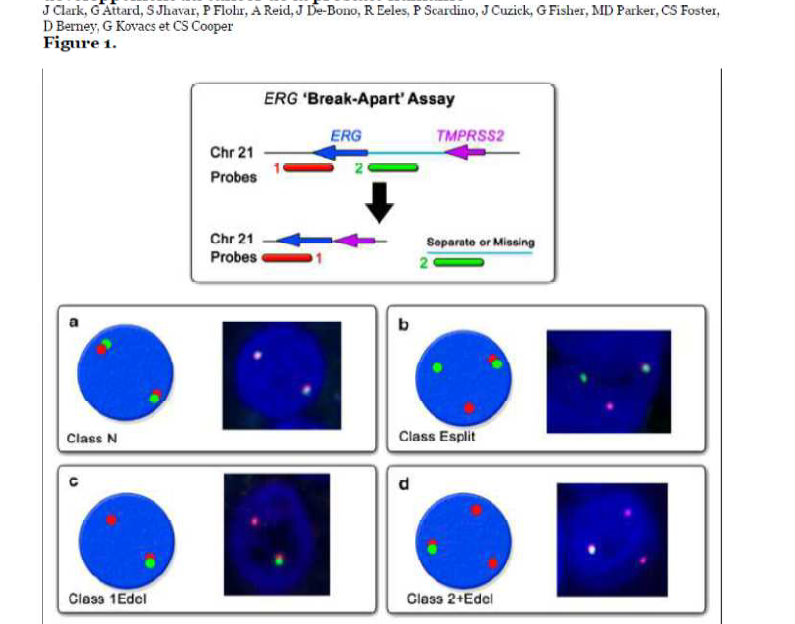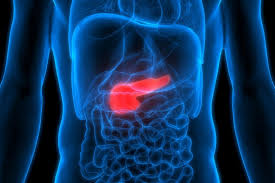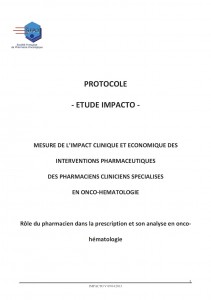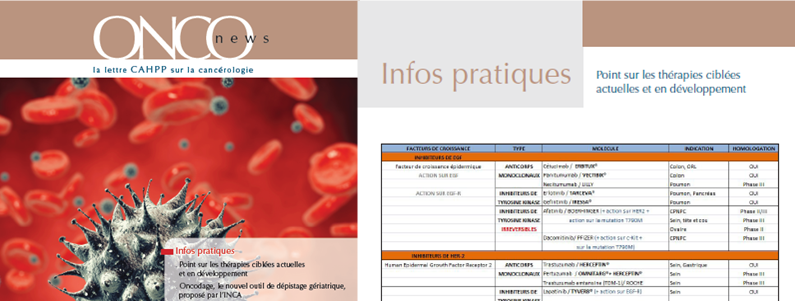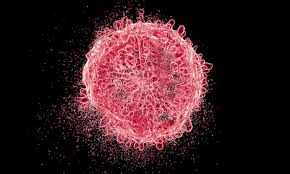| Etude rétrospective des allergies aux cytotoxiques dans un service d’oncologie thoracique | Pharmacie Clinique | CAPELLE Héloïse | Université d'Aix-Marseille | Consulter la thèse | 2017 |
| Etude des facteurs pronostiques de survie des carcinomes neuroendocrines | Pharmacie Clinique | FREIS Patricia | Université Claude Bernard, Lyon | Consulter la thèse | 2017 |
Performance de l’outil DRUGCAM®
en activité réelle de production par la simulation | Pharmacotechnie | LAPLACE Marie | Université de Poitiers | | 2017 |
| Diagnostic moléculaire du carcinome hépatocellulaire sur ADN circulant | Biologie Clinique | LEBREDONCHEL Elodie | Université de Lille 2 | Consulter la thèse | 2017 |
Sécurisation du circuit hospitalier de préparation des
chimiothérapies : application de l’analyse de risque
à priori | Pharmacotechnie | HENRY Nicolas | Université de Rouen | | 2017 |
Mise en place de la caractérisation GCB / ABC des lymphomes diffus à
grandes cellules B par une technique de Reverse Transcription – Multiplex
Ligation-Dependent Probe Amplification | Recherche fondamentale | FUSARO Mathieu | Université Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | Consulter la thèse | 2017 |
| Perspective d'un suivi thérapeutique pharmacologique de l'évérolimus en cancérologie? Résultats d'une étude explorative de la relation concentration-effet de l'évérolimus | Pharmacie Clinique | DEPPENWEILER Marine | Université de Bordeaux | | 2017 |
| Analyse préliminaire des risques appliquée à la mutualisation de la préparation de médicaments anticancéreux | Pharmacotechnie | GERAUDIE Bastien | Université de Paris Descartes | | 2017 |
| Evalutation de l'impact clinique des allo-immunisations humorales anti-HLA du couple donneur-receveur avant et après greffes haplo-identiques non manipulées avec conditionnement non myéloablatif | Pharmacie Clinique | BESBES Ibtissem | Université d'Aix-Marseille | | 2017 |
| Caractérisation des lymphocytes T CD4 et CD8 PD-1+ chez des patients atteints d'un cancer métastatique et traités par des anticorps antagonistes de la molécules PD-1 | Recherche fondamentale | DUPRAZ Louise | Université Paris-Descartes | | 2017 |
Neurotoxicité de l’oxaliplatine :
de l’exploration clinique à la prise en charge éducative de la neuropathie | Pharmacie Clinique | DELMOTTE Jean-Baptiste | Université Paris Sud - Paris Saclay | Consulter la thèse | 2017 |
Impact des réductions arbitraires des doses de cytotoxique sur le devenir des
patients obèses atteints de lymphome diffus à grandes cellules B | Pharmacie Clinique | GAY Caroline | Université de Nantes | Consulter la thèse | 2017 |
| Prise en charge du risque professionnel lié à l’exposition aux agents anticancéreux : enquête régionale dans les établissements de santé de Lorraine | Pharmacologie / Pharmacocinétique | GIOVANELLI Morgane | Université de Lorraine | | 2017 |
| Implication des transporteurs rénaux OCT2, MATE1 et MATE-2K dans l'intéraction Pazopanib/Cisplatine | Recherche fondamentale | SAUZAY Chloé | Université Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2017 |
Imagerie in-vivo du microenvironnement tumoral du myélome
multiple par TEMP/CT | Recherche fondamentale | COSTES Julien | Université de Limoges | Consulter la thèse | 2017 |
| Étude de l’effet du bévacizumab sur la survie des patients atteints de glioblastome au Centre Georges François Leclerc entre 2004 et 2014 | Pharmacie Clinique | TANG Raksamy | Université de Bourgogne | Consulter la thèse | 2017 |
| Bactériologie et Cancers : vers de nouvelles stratégies thérapeutiques | Biologie Clinique | ALBERT Quentin | Université de Caen | Consulter la thèse | 2017 |
Surveillance urinaire des professionnels de santé exposés
aux antinéoplasiques en oncologie : étude pilote
canadienne et perspectives françaises | Pharmacotechnie | POUPEAU Céline | Université de Lorraine | Consulter la thèse | 2017 |
| Traitement du myélome multiple en rechute et réfractaire par pomalidomide : expérience au CHU de Dijon | Pharmacie Clinique | GUENEAU Pauline | Université de Bourgogne | | 2017 |
| Etat des liex sur la prévention et la gestion des nausées et vomissements chimio-induits en onco-hématologie pédiatrique : pour une optimisation des prises en charges | Pharmacie Clinique | MOUFFAK Samia | Université Paris Sud | Consulter la thèse | 2017 |
| Association d’une chimiothérapie à base de platine au cetuximab (protocole EXTREME) dans les cancers des voies aérodigestives supérieures : étude rétrospective dans un Centre de Lutte Contre le Cancer | Pharmacie Clinique | REGNIER-GAVIER Olivier | Université de Strasbourg | | 2017 |
| Formation continue des préparateurs en pharmacie hospitalière travaillant en unité de préparation des anticancéreux | Pharmacotechnie | MOINE Marion | Université Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2017 |
| Evaluation de l'activité anticancéreuse d'un nouveau dérivé pyrrolo-pyrimidine (PP-13) ciblant les microtubules dans les cancers broncho-pulmonaires non-a-petites cellules résistants | Pharmacie Clinique | GILSON Pauline | Université Grenoble Alpes | | 2017 |
Place de l’estramustine phosphate dans le traitement du cancer du sein métastatique
et évaluation de l’expérience du centre expert des maladies du sein
de l’hôpital Tenon | Pharmacie Clinique | GAUDAS Julien | Université de Paris Descartes | Consulter la thèse | 2017 |
| Evaluation de la toxicité rénale du phosphate d’étoposide administré à haute dose dans le conditionnement de greffe de cellules souches hématopoïétiques en hématologie pédiatrique : étude rétrospective monocentrique | Pharmacie Clinique | BARNOUD Delphine | Université de Lille 2 | | 2017 |
| De la versatilité des cellules de Sézary circulantes et résidentes | Biologie Clinique | ROELENS Marie | Université de Paris Descartes | Consulter la thèse | 2017 |
| Mise en place d'une consultation pharmaceutique pour les patients traités pour myélome multiple. Etude préliminaire à une éducation thérapeutique | Pharmacie Clinique | MARTIN Audrey | Université de Caen | Consulter la thèse | 2017 |
Analyse rétrospective de l'utilisation du Bévacizumab en association
à l'lrinotecan chez les patients atteints de glioblastome récidivant au Centre Paul Strauss entre
2007 et 2013 | Pharmacie Clinique | BESSON Charlotte | Université de Strasbourg | Consulter la thèse | 2017 |
Place
du
pharmacien
clinicien
dans
une
consultation
pluridisciplinaire
d’oncogériatrie
en
ambulatoire
:
intérêts
et
perspectives | Pharmacie Clinique | CHOUKROUN Chloé | Université de Montpellier | | 2017 |
Physicochimie des anticorps thérapeutiques :
Impact de la séquence primaire sur l’agrégation | Recherche fondamentale | BRACHET Guillaume | Université François Rabelais de Tours | Consulter la thèse | 2017 |
Réorganisation d'une unité de production hospitalière de
chimiothérapies par une méthode Lean Six Sigma | Pharmacotechnie | MARTIN Vincent | Université de Grenoble | | 2017 |
| Optimisation du diagnostic des thrombopénies constitutionnelles par l’utilisation des paramètres plaquettaires morphométriques | Biologie Clinique | DOUCET François-Xavier | Université de Lorraine | Consulter la thèse | 2017 |
| Gestion des risques et simulation en santé : application au secteur de reconstitution des chimiothérapies | Pharmacotechnie | GIRAULT Chloé | Université Toulouse III Paul Sabatier | | 2017 |
| Évaluation du coût d'un cancer du rein métastatique en Franche-Comté | Pharmacoeconomie / Santé publique | CHOLLEY Tiphaine | Université de Franche-Comté | | 2017 |
| Etude de faisabilité de la mise en place d'automates pour la préparation des chimiothérapies au sein des unités de reconstitution des cytotoxiques de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) | Pharmacotechnie | GRIMAUX Julie | Université d'Aix-Marseille | Consulter la thèse | 2017 |
| Liquides d’épanchements: analyse par l’hématimètre XN (SYSMEX®), évaluation de la formule automatisée et mise en évidence des cellules pathologiques par cytométrie en flux | Biologie Clinique | GERARD Delphine | Université de Lorraine | | 2017 |
Implication de la voie mTORC1 dans le contrôle de
la glycolyse dans les leucémies aigües myéloïdes | Recherche fondamentale | BARREAU Sylvain | Université de Paris Descartes | | 2017 |
| Evaluation et optimisation des pratiques de perfusion dans un centre de lutte contre le cancer | Pharmacie Clinique | BOURHIS Matthieu | Université Paris Sud, Faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | Consulter la thèse | 2017 |
Etude des polymorphismes du VEGF dans le développement du carcinome rénal chez les patients
transplantés rénaux | Recherche fondamentale | QUINTON Marie-Charlotte | Univ. de Picardie, Jules Vernes | Consulter la thèse | 2017 |
| Formation des préparateurs en pharmacie au sein d'une unité de préparation des cytotoxiques : conception, mise en œuvre et évaluation d'un dispositif de formation initiale et continue | Pharmacotechnie | CARRE épouse MALAVAL Nathalie | Université de Paris Descartes | | 2017 |
| Adaptations posologiques du 5-fluorouracile, de la capécitabine et de l'irinotécan après génotypage de la DPYD et de l'UGT1A1 et phénotypage de la DPD : analyse des pratiques au CHU de Limoges et à l'institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) Oncopole | Pharmacie Clinique | ANQUETIL Marie | Université de Bordeaux | Consulter la thèse | 2017 |
| La spécialité Ifosfamide EG® engendre-t-elle plus d'encéphalopathie que la spécialité Holoxan®? Etude au CHU de Grenoble | Pharmacie Clinique | VIARD GAUDIN Gwendal | Université de Grenoble Alpes | | 2017 |
| Intérêt de l'activité de la cytidine deaminase dans la prise en charge des patients traités par Azacitidine | Biologie Clinique | KIMBIDIMA-MAKOUNDOU Reine | Faculté de Pharmacie Aix-Marseille | Consulter la thèse | 2017 |
Développement et
évaluation de
nanoparticules
dérivées du
poly(acide malique)
ciblant les cellules
hépatiques
cancéreuses
humaines | Recherche fondamentale | VENE Elise | Université de Rennes | Consulter la thèse | 2017 |
| Mise en place du contrôle analytique des préparations de chimiothérapies injectables pédiatriques sur automate QCPrep+ | Contrôles analytiques | CHOUQUET
Thibaut | Univ. Paris Descartes | Consulter la thèse | 2017 |
| Trastuzumab par voie sous-cutanée : quels impacts en pratique? | Pharmacie Clinique | LECA Marion | Université d'Aix-Marseille | | 2017 |
Changement de pratiques au CHU Ste-Justine (Montréal) :
Mise en place des perfusions rapides de rituximab dans une population pédiatrique | Pharmacie Clinique Oncologique | LEGEAY Clément | Université d'Angers | | 2015 |
| Cytotoxiques injectables en dose standard préparés par lot : Stabilité microbiologique et test d'intégrité physique des conditionnements | Stabilités | MATHERON Agnès | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2015 |
| Neurotoxicité induite par le Thiotepa haute dose en oncopédiatrie | Pharmacologie / Pharmacocinétique | MARITAZ Christophe | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2015 |
| Évaluation du risque d'exposition professionnelle lié à la manipulation des cytotoxiques dans une unité d'hospitalisation de jour d'oncologie digestive | Pharmacotechnie | REITTER Delphine | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2015 |
| Standardisation des doses d’anticancéreux : enquête européenne et extension du concept aux services d’Hépato-Gastroentérologie, de Pneumologie et de Neurologie du CHU de Nancy | Pharmacotechnie | LOBODA Caroline | Université de Lorraine | | 2015 |
| Chimiothérapie métronimique : stratégie thérapeutique originale et prometteuse en oncologie pédiatrique | Pharmacologie / Pharmacocinétique | BONDARENKO Maryna | Université d'Aix-Marseille | Consulter la thèse | 2015 |
| Efficacité de l'association Bevacizumab-Paclitaxel en pratique clinique oncologique courante. Étude comparative de 2 groupes de patientes | Pharmacie Clinique Oncologique | AIT ICHOU Myriam | Université de Lyon, Claude Bernard | | 2015 |
| Prévention des erreurs médicamenteuses en cancérologie par la simulation : Simmeon-Prep | Pharmacie Clinique Oncologique | SARFATI Laura | Université de Lyon, Claude Bernard | | 2015 |
| Enjeux de la caractérisation des altérations moléculaires du cancer médullaire de la thyroïde sur l'émergence des thérapies ciblées : illustration par le développement clinique d'un inhibiteur de tyrosine kinase, le Lucitanib | Recherche fondamentale | CROUX BELGODERE Laetitia | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2015 |
| Effet des adipocytes sur la progression tumorale de cellules cancéreuses d’origine hématopoïétique et rôle de l’adénosine | Recherche fondamentale | BOSSARD Cécile | Université de Lyon, Claude Bernard | Consulter la thèse | 2015 |
Evaluation d’un nouveau score diagnostique par
cytométrie en flux, le RED-score, dans les syndromes
myélodysplasiques | Biologie Clinique | MAURER Maxime | Université de Strasbourg | | 2015 |
Esanté : Intérêt dans la prise en charge des pathologies chroniques
Evaluation des applications mobiles de santé en Oncologie et propositions de nouveaux outils | Pharmacoeconomie / Santé publique | BROUARD Benoit | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2015 |
| Sécurisation de la préparation et de l’administration par voie centrale des préparations anticancéreuses injectables au Centre Hospitalier Bretagne Sud | Pharmacie Clinique Oncologique | LATOUCHE Hélène | Université de Nantes | Consulter la thèse | 2015 |
| Prise en charge du carcinome hépatocellulaire par chimioembolisation lipiodolée : comparaison de deux stratégies thérapeutiques | Pharmacie Clinique Oncologique | TAVERNIER Jérôme | Université de Bourgogne | | 2015 |
| Sous-traitance des chimiothérapies anticancéreuses : Etude d’une coopération public-privé | Pharmacotechnie | BESSONE Marion | Université d'Aix-Marseille | | 2015 |
| Identification et caractérisation des cellules tumorales circulantes dans le cancer colorectal | Recherche fondamentale | GRILLET Fanny | Université Montpellier I | | 2015 |
| Évaluation post-autorisation de mise sur le marché de l’efficacité et de la tolérance du topotécan injectable dans le traitement du cancer bronchique à petites cellules au Centre Antoine Lacassagne | Pharmacie Clinique Oncologique | FERREIRA Vanessa | Université d'Aix-Marseille | | 2015 |
| Amélioration des modalités d'administration du 5-Fluorouracile en perfusion continue chez les patients atteints de cancer colorectal et pris en charge sur le groupe hospitalier sud du CHU de Bordeaux | Pharmacie Clinique Oncologique | LEYMOND Soizic | Université de Bordeaux | | 2015 |
| Evaluation de la fraction libre du Voriconazole et corrélations clinico-biologiques | Pharmacologie / Pharmacocinétique | FLORENT Aurélie | Université de Bordeaux II, Victor Segalen | | 2015 |
| Etude rétrospective de la mutation L265P de MYD88 et du suivi de 26 cas de lymphocytose B monoclonale au CHU Limoges entre 2005 et 2012 | Recherche fondamentale | LECHEVALIER Nicolas | Université de Limoges | | 2015 |
| Potentialisation in vitro de l’effet antiprolifératif de l’ibrutinib par la dexamethasone sur les cellules lymphoïdes B. Application à la leucémie lymphoïde chronique. | Recherche fondamentale | MANZONI Delphine | Université de Lyon, Claude Bernard | | 2015 |
| Ciblage de l’axe EGFR/mTOR/HIF-1α dans les cancers des voies aérodigestives supérieures | Recherche fondamentale | COLIAT Pierre | Université de Strasbourg | | 2015 |
| Les préparations hospitalières : partie intégrante de l'organisation de l'unité de production des anticancéreux de l'hôpital St Louis | Pharmacotechnie | MENARD Caroline | Université de Paris Descartes | | 2015 |
| La chimiothérapie métronomique en oncologie pédiatrique : principes et illustrations au CHU de Reims | Pharmacologie / Pharmacocinétique | LAUGUEUX Aurore | Université de Rennes 1 | Consulter la thèse | 2015 |
| Suivi de l'efficacité et des effets indésirables de l'Axitinib après sa commercialisation à l'institut Claudius Regaud | Pharmacologie / Pharmacocinétique | MOLINIER Alicia | Université de Toulouse III, Paul Sabatier | | 2015 |
| Chimiothérapies dans le cancer colorectal : évaluation des modifications de prescriptions | Pharmacie Clinique Oncologique | THIBAULT Vanessa | Université Montpellier I | Consulter la thèse | 2015 |
| Traitement de la réactivation du virus Epstein Barr par le Rituximab chez les patients allogreffés de cellules souches hématopoiétiques : efficacité et tolérance. Étude rétrospective au CHU de Montpellier | Pharmacie Clinique Oncologique | ALARY Virginie | Université Montpellier I | | 2015 |
| Évaluation de l’ADN circulant dans le plasma de patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B | Recherche fondamentale | DE SAINT JORE Mylène | Université de Rennes 1 | | 2015 |
| Développement d’un suivi pharmaceutique des patients traités par anticancéreux oraux dans le cancer du rein | Pharmacie Clinique Oncologique | POULAT Charlotte | Université de Strasbourg | | 2015 |
| Evaluation préclinique d'un traceur TEP dédié à l'étude fonctionnelle de la P-Glycoprotéine au niveau de la barrière hémato-encéphalique | Imagerie | MARIE Solène | Université de Paris Descartes | | 2015 |
| Le vismodegib : revue de la littérature et expérience dans la prise en charge du cancer basocellulaire au CHU de Bordeaux | Pharmacie Clinique Oncologique | STREICHER Caroline | Université de Bordeaux | | 2015 |
| Étude de comparaison des allogreffes de moelle osseuse après conditionnement myéloablatif standard ou conditionnement myéloablatif à toxicité réduite dans les leucémies aigues myéloïdes et les syndromes myélodysplasiques | Pharmacie Clinique Oncologique | PAYSANT Céline | Université Montpellier I | Consulter la thèse | 2015 |
| Sécurisation du circuit du médicament et pharmacotechnie | Pharmacotechnie | CORREARD Florian | Université d'Aix-Marseille | | 2015 |
| VSM et OBEYA, 2 outils de LEAN Management au service de la Pharmacie Hospitalière | Pharmacie Clinique Oncologique | DESCOUT Jérôme | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2015 |
| Évolution de la base de données Stabilis® : Création d’un système de cotation des publications relatives aux études de stabilité de médicaments anticancéreux | Stabilités | LIDER Pauline | Université de Lorraine | | 2015 |
| Instauration d’un processus de qualification du personnel à la manipulation des médicaments anticancéreux, de la Pharmacie à Usage Intérieur de Centre Hospitalier d’Agen | Pharmacotechnie | ROUGE Nicolas | Université de Toulouse | | 2015 |
| Tolérance du docétaxel selon la formulation de la spécialité Taxotere® : étude rétrospective sur 107 patientes traitées pour un cancer du sein localisé au Groupe Hospitalier Diaconesses – Croix Saint-Simon | Pharmacologie / Pharmacocinétique | CHANAT Cédric | Université de Paris Descartes | Consulter la thèse | 2015 |
| Pratiques de prescription des inhibiteurs de tyrosine kinase et impact clinique et biologique dans le traitement de la LMC | Pharmacie Clinique Oncologique | LANG Anne-Sophie | Université de Bourgogne | | 2015 |
| Effets indésirables induits par les chimiothérapies anticancéreuses : optimisation de l'analyse pharmaceutique | Pharmacie Clinique Oncologique | ROSE Jimmy | Université de Paris Descartes | | 2015 |
| Rôle de l’hypoxie et de l’héparanase dans la signalisation HGF/SF-MET | Recherche fondamentale | MEKKI Meriem Sarah | Université de Lille 2 | | 2015 |
| Taux de PSA et performance de la TEP à la [18F]fluorocholine dans la détection des récidives de cancer de la prostate : revue de la littérature et étude sur 195 patients | Biologie Clinique | PARET Audrey | Université de Paris Descartes | | 2015 |
| La standardisation des doses : une méthode pour optimiser la préparation des anticancéreux au Centre Hospitalier de Versailles | Pharmacotechnie | CALLANQUIN Marie | Université de Paris Descartes | Consulter la thèse | 2015 |
| Étude de nouveaux biomarqueurs tumoraux et détermination de leurs impacts sur la réponse aux thérapies ciblées dans le traitement du cancer du sein | Biologie Clinique | LION Maëva | Université de Lorraine | Consulter la thèse | 2015 |
| Mutations de isocitrate déshydrogénases dans les leucémies aigües myéloïdes : vers de nouvelles approches thérapeutiques | Recherche fondamentale | BOUTZEN Héléna | Université de Toulouse III, Paul Sabatier | | 2015 |
| Étude clinique et économique de la prise en charge du cancer bronchique non à petites cellules au stade avancé ou métastatique | Pharmacoeconomie / Santé publique | HUGUES Marion | Université de Franche-Comté | | 2015 |
| Préparation des médicaments anticancéreux : mise en œuvre et évaluation d'un outil de formation théorique à destination des préparateurs en pharmacie hospitalière | Pharmacotechnie | DANGUY DES DESERTS Laurene | Université de Poitiers | | 2015 |
| Toxicités d'une chimiothérapie adjuvante séquentielle FEC 100-Docétaxel dans le traitement du cancer du sein Etude comparative entre les patientes de plus et de moins de 65 ans | Pharmacie Clinique Oncologique | BOIN Christopher | Université de Strasbourg | | 2015 |
| Tff1 Et Tff3 Dans Les Cancers Du Sein | Recherche fondamentale | DELPOUS Stéphanie | Université de Strasbourg | Consulter la thèse | 2013 |
| Lerlotinib Est-Il Un Candidat Au Suivi Thérapeutique Pharmacologique ? | Pharmacologie / Pharmacocinétique | PETIT-JEAN Emilie | Université de Strasbourg | | 2013 |
| Optimisation De La Production D'Une Unité De Préparation Des Anticancéreux : Les Préparations Hospitalières. | Pharmacotechnie | GAUTHIER Matthieu | Université de Paris Descartes | Consulter la thèse | 2013 |
| Interet Du Bevacizumab Associe A Une Chimiotherapie Combinant Le Fluorouracile Et La Vinorelbine Dans Le Cancer Du Sein Metastatique Chez Des Femmes Prealablement Traitees Par Un Taxane. | Pharmacie Clinique | FINZI Jonathan | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | Consulter la thèse | 2013 |
| Prise En Charge Des Neutropenies Febriles Apres Chimiotherapie Dans Le Cancer Bronchique : Etude Retrospective Dans Le Service De Pneumologie Du Chu De Caen | Pharmacie Clinique | BREUIL Cécile | Université de Caen | | 2013 |
Evaluation De La Valeur Prédictive De L'Origine Cellulaire
Gc/Nongc Sur La Réponse Métabolique Des Traitements De
Première Ligne Des Patients Atteints De Lymphome B Diffus À
Grandes Cellules | Pharmacologie / Pharmacocinétique | VERRIERE Benjamin | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2013 |
| Leucémies Aiguës Myeloïdes Secondaires Aux Traitements Dans Le Cancer Du Sein : Etude De Pharmaco-Epidemiologie Au Sein DUn Centre De Lutte Contre Le Cancer. | Pharmaco-économie / Pharmaco epidémiologie | CORNEN Stéphanie | Université d'Aix-Marseille | | 2013 |
Actualisation Des Protocoles Antiemetiques Associes Aux
Chimiotherapies Au Chi De Creteil Création DOutils Pratiques Et Évaluation De LImpact Sur Les Patients | Pharmacie Clinique | THIRIAT Nadine | Université de Paris Descartes | | 2013 |
Chimiothérapie Orale : Optimisation Du Lien Ville/Hôpital
Elaboration DUn Dispositif De Coordination Entre LInstitut Bergonié Et Les Pharmacies DOfficine | Pharmacie Clinique | RENARD Pierre-Yves | Université de Limoges | Consulter la thèse | 2013 |
Intérêt D'Une Consultation Pharmaceutique Dans La Prise En Charge
Des Interactions Médicamenteuses Des Patients De Plus De 65 Ans
Recevant Un Traitement Médical Pour Cancer. | Pharmacie Clinique | STEVE-DUMONT Marie | Université Montpellier | Consulter la thèse | 2013 |
| Impact Des Comorbidites Sur LEfficacite Et La Toxicite Des Immunochimiotherapies Prescrites En Premiere Ligne Dans La Leucemie Lymphoïde Chronique : Etude Rétrospective De 209 Patients Dans Le Réseau Oncomip | Pharmacie Clinique | BOUVET Emmanuelle | Université de Toulouse III, Paul Sabatier | | 2013 |
Chimiothérapies Injectables À Domicile En Région Centre :
État Des Lieux Et Perspectives | Pharmacie Clinique | COUDER Fanny | Université de Poitiers | Consulter la thèse | 2013 |
| Evaluation De LEfficacité Et De La Toxicité Du Protocole Folfox En 1Ère Ligne Dans Le Cancer Colorectal Métastatique Chez Des Patients En Surpoids Ou Obèses Ou Ayant Une Surface Corporelle Supérieure À 2 M2 | Pharmacie Clinique | DUQUESNE Julien | Université de Paris 11, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2013 |
Etude Rétrospective Monocentrique : Coût-Efficacité D'Une
Mobilisation Des Cellules Souches Périphériques Pour L'Autogreffe
De Patients Mauvais Mobilisateurs Atteints De Myélome Multiple Ou
De Lymphome Mobilisés Ou Non Par Plerixafor | Pharmaco-économie / Pharmaco epidémiologie | LOISON Aurélien | UFR de Rouen | | 2013 |
Securisation De La Prise En Charge Medicamenteuse :
Apport DUne Nouvelle Methode DAnalyse De Risques
Appliquee Au Circuit Des Chimiotherapies | Pharmacie Clinique | COMTE Hélène | Université de Lille 2 | | 2013 |
Impact Des Biotherapies Sur Le Pronostic Et Le Coût
De Prise En Charge Du Cancer Colorectal Metastatique | Pharmaco-économie / Pharmaco epidémiologie | BICHARD Damien | Université de Franche-Comté | | 2013 |
| Evaluation Des Pratiques De Prescription Des Serologies Et Des Charges Virales Du Virus Epstein-Barr Chez Les Greffes De Rein Et De Cellules Souches Hematopoietiques Aux Hopitaux Universitaires De Strasbourg | Pharmacie Clinique | FILALI Fécel | Université de Strasbourg | | 2013 |
| Le Composé 4321 : Étude D'Une Nouvelle Molécule Anti Angiogène Ayant Pour Cible Le Récepteur Au Vegf De Type 1 (Vegfr-1) | Recherche fondamentale | ALILI Jean-Meidi | Université de Paris Descartes | | 2013 |
| Le Chemin Clinique Du Patient Recevant Une Chimiothérapie À L'Hôpital De Jour : En Route Vers Le Lean Management | Pharmacie Clinique | KLASEN Alison | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2013 |
| Chimiotherapie Hyperthermique Intraperitoneale Peroperatoire : Etude Des Risques De Contamination Du Personnel Par Les Sels De Platine Au Bloc Operatoire | Pharmacie Clinique | GASTAUT Nadia | Université Montpellier 1 | | 2013 |
Etude De LHétérogénéité Moléculaire Et De La Réponse Thérapeutique
Des Néoplasies Myéloprolifératives Bcr-Abl1 Négatives | Recherche fondamentale | LESTEVEN Elodie | Université de Paris Descartes | | 2013 |
| Suivi Therapeutique Pharmacologique Du Methotrexate Dans Le Cadre Des Protocoles Haute Dose En Hematologie Pediatrique : Analyse DUne Cohorte Monocentrique | Pharmacologie / Pharmacocinétique | GUERRIERO Emilie | Université de Lille 2 | | 2013 |
Posologie Élevée De Ganciclovir Pour Le Traitement Des Infections À
Cytomégalovirus En Hématologie Pédiatrique : Etude De La Cinétique
Des Charges Virales | Pharmacologie / Pharmacocinétique | CHAUVIN Cécile | Université de Lyon, Claude Bernard | | 2013 |
| Evaluation Du Bénéfice Et De La Tolérance Des Anthracyclines Après La Première Ligne Métastatique Chez Des Patientes Atteintes De Cancer Du Sein | Pharmacie Clinique | BERNHARD Sandrine | Université de Franche-Comté | | 2013 |
Manipulation Des Cytotoxiques En Milieu Hospitalier :
Outil DÉvaluation Du Risque DExposition Chimique Professionnelle | Pharmacotechnie | Lê Laetitia Minh Mai | Université de Paris 11, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2013 |
| Étude De L'Impact De L'Utilisation De La Formule Mdrd Pour L'Estimation De La Fonction Rénale Des Patients Traités Par Sels De Platine Au Chru De Tours | Pharmacie Clinique | KUZZAY Marie-Pierre | Université de Tours, François Rabelais | Consulter la thèse | 2013 |
Evaluation Des Pratiques Professionnelles : Audit Clinique Sur
LUtilisation De La Rasburicase Dans Le Syndrome De Lyse Tumorale | Pharmacie Clinique | ANNEREAU Maxime | Université de Paris Descartes | Consulter la thèse | 2013 |
| Communication Patient : Elaboration D'Outils D'Information Sur Le Circuit Des Chimiotherapies Injectables En Milieu Hospitalier | Pharmacie Clinique | JOBARD Marion | Université de Paris Sud, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | Consulter la thèse | 2013 |
Étude De La Stabilité Physique, Chimique Et Biologique
De Solutions Diluées De L-Asparaginase | Stabilité | d'HAYER Benoit | Université de Paris Descartes | | 2013 |
| Immunothérapie Anti-Tumorale Active Par Vecteur Bactérien Vivant Attenué : Mise Au Point De LApproche Vaccinale « Killed But Metabolically Active » | Recherche fondamentale | CHAUCHET Xavier | Université de Grenoble, Joseph Fourier | Consulter la thèse | 2013 |
| Étude Du Statut Mutationnel Du Facteur De Transcription Ikaros Dans La Cohorte De Leucémies Aiguës Lymphoblastiques B Suivies Aux Hôpitaux Universitaires De Strasbourg | Recherche fondamentale | DUPUIS Arnaud | Université de Strasbourg | | 2013 |
| Revue De Morbi-Mortalité Sur Les Évènements Indésirables Associés À La Chimiothérapie Anticancéreuse : Quelle Organisation Pour Quels Résultats ? | Pharmacie Clinique | LOTTIN Marion | UFR de Rouen | | 2013 |
| Développement, Management Et Evaluation DUn Projet Innovant En Milieu Hospitalier : Application Au Dispositif « Drugcam® » | Pharmacotechnie | CHAUVET Pierre | Université de Nantes | Consulter la thèse | 2013 |
| Rôle Des Plaquettes Dans LAgressivité Tumorale | Recherche fondamentale | DELAGE Judith | UFR de Rouen | | 2013 |
Potentiel Diagnostique Et Therapeutique Des Microarn
Application Au Carcinome Medullaire De La Thyroide | Recherche fondamentale | BOICHARD Amélie | Université de Paris 11, faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry | | 2013 |
| Le rôle du pharmacien au sein d'une équipe soignante : mise en place et évaluation d’une activité de pharmacie clinique dans le service d’hospitalisation continue d’oncologie et d’hématologie du CHU de Brest. | Pharmacie Clinique Oncologique | Charlotte TANGUY GOARIN | Université Rennes 1 | | 2011 |
| Faisabilité et intérêt diagnostique de la recherche de mutations dans les cancers thyroïdiens à partir des produits de cytoponctions | Recherche fondamentale | Séverine ALAIN | Université Caen | | 2011 |
| Prise en charge des patients en cancérologie : développement d’une prestation de pharmacie clinique adaptée aux besoins du centre hospitalier de Blois | Pharmacie Clinique Oncologique | Mylaine CORJON | Université Rennes 1 | | 2011 |
| Stabilité des médicaments anticancéreux injectables après reconstitution et dilution | Stabilités | Chloe BOUSQUET | Université de Tours, François Rabelais | Consulter la thèse | 2011 |
| Identification d'un nouveau facteur de risque de retard d'élimination et d'intoxication au méthotrexate : les inhibiteurs de la pompe à protons | Pharmacologie / Pharmacocinétique | Raoul SANTUCCI | Université de Strasbourg | Consulter la thèse | 2011 |
| Dix années d'évolution de prise en charge du cancer du sein métastatique : impact clinique et économique | Pharmacoeconomie / santé publique | Sophie PERRIN | Université de Franche-Comté | | 2011 |
| Pharmacocinétique de population et relation pharmacocinétique /pharmacodynamique de l'Erlotinib (Tarceva), chez l'adulte et l'enfant | Pharmacologie / Pharmacocinétique | Elodie CIVADE | Université de Toulouse III, Paul Sabatier | | 2011 |
| ADAPTATION DES POSOLOGIES D’ANTICANCÉREUX EN FONCTION DE LA SURFACE CORPORELLE CHEZ LES PATIENTS EN SURCHARGE PONDÉRALE ATTEINTS DE TUMEURS SOLIDES : REVUE DE LA LITTÉRATURE | Pharmacie Clinique Oncologique | Emilie DUBOST | CHU Poitiers | Consulter la thèse | 2011 |
| Effets de l’adrénaline sur les paramètres pharmacocinétiques du cisplatine administré au cours des chimiothérapies intrapéritonéales peropératoires : analyse en pharmacocinétique de population | Pharmacologie / Pharmacocinétique | Sylvain ONTENIENTE | Université de Bourgogne | | 2011 |
| Etude de stabilité d’une suspension d’azacitidine à 25 mg/mL en seringues de polypropylène après congélation à -20°C Application à la production en Unité de Reconstitution Centralisée des Cytotoxiques | Stabilités | Audrey DURIEZ | Université de Nancy, Henri Poincaré | | 2011 |
EPIDEMIOLOGIE DES LEUCEMIES AIGUES DE PATIENTS DROMOIS ET ARDECHOIS DIAGNOSTIQUEES AU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE DE 2005 A 2010
| Pharmacoeconomie / Santé publique | Lydvine RAIDELET | Université Joseph Fourier | Consulter la thèse | 2011 |
| Acquisition et mise en place d’un automate de contrôles analytiques des préparations injectables de cytotoxiques dans une unité de biopharmacie oncologique. Impact qualité et conséquences sur l’organisation de l’unité. | Contrôles analytiques | Jerome AUBERT | Université de Tours, François Rabelais | Consulter la thèse | 2011 |
| ROLE DU RECEPTEUR DES XENOBIOTIQUES CAR (CONSTITUTIVE ANDROSTANE RECEPTOR) DANS LA REPONSE AUX CHIMIOTHERAPIES CONVENTIONNELLES | Recherche fondamentale | Géraldine LEGUELINEL | Université Montpellier I | | 2011 |
| IMPACT PRONOSTIQUE DE LA TEP AU 18FDG ET DE LA SCINTIGRAPHIE CORPS ENTIER A L’IODE 131 DANS LES CANCERS THYRO DIENS METASTATIQUES | Imagerie | Elsa LEMOINE | Université d'Aix-Marseille | | 2011 |
| PHARMACIE CLINIQUE APPLIQUÉE A LA SÉCURISATION DU CIRCUIT DES ANTICANCÉREUX INJECTÉS PAR VOIE INTRATHÉCALE AU SEIN D’UN CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCE | Pharmacie Clinique Oncologique | Guillaume Marliot | CH de Roubaix | Consulter la thèse | 2011 |
| EVALUATION DE L’EFFICACITE ET DU COUT DE LA CHIMIOTHERAPIE NEOADJUVANTE DANS LE CANCER DU SEIN : ETUDE RETROSPECTIVE PORTANT SUR 80 PATIENTES TRAITEES AU CHU DE GRENOBLE | Pharmacoeconomie / Santé publique | Emilie Franchon | Université de Lyon Sud | | 2011 |
| Apports du pharmacien hospitalier en pharmacovigilance au sein d’un centre de lutte contre le cancer : Exemple des hémopathies myéloïdes induites par les chimiothérapies anticancéreuses | Pharmacologie / Pharmacocinétique | Julien Rocquain | INSERM U823 CHU Grenoble | Consulter la thèse | 2011 |
| IMPACT MEDICO-ECONOMIQUE DE LA PREVENTION DES ERREURS MEDICAMENTEUSES EN CANCEROLOGIE Etude prospective d’un an au Groupement Hospitalier Sud Hospices Civils de Lyon | Pharmacie Clinique Oncologique | Florence RANCHON | Université de Lyon Sud | | 2011 |
| Rôle de l’amphiréguline dans la résistance du cancer du poumon non-à petites cellules au gefitinib | Recherche fondamentale | Benoît BUSSER | Université de Grenoble | Consulter la thèse | 2011 |
| Intérêt et Mise en place au CHU d’Amiens du Suivi Thérapeutique Pharmacologique du Voriconazole et du Posaconazole Validation de la méthode de dosage par chromatographie liquide haute performance - barrette de diodes | Pharmacologie / Pharmacocinétique | Charlotte MAUGARD | CHU Amiens | | 2011 |
| IMPACTS CLINIQUE ET ECONOMIQUE DE L’UTILISATION DE NOUVELLES MOLECULES DE CHIMIOTHERAPIE DANS LE CANCER DU SEIN METASTATIQUE : ETUDE COMPARATIVE DE 2 COHORTES DE PATIENTES 1994-1998 et 2003-2006 | Pharmacie Clinique Oncologique | Guillaume GALY | Université de Lyon, ISPB | Consulter la thèse | 2011 |
| INFORMATIONS DE PHARMACOGENETIQUE A DESTINATION DES MEDECINS ET DES PHARMACIENS. EXEMPLE DES ANTICANCEREUX. | Pharmacie Clinique Oncologique | Laetitia ALBERTINI | Université de Nancy | | 2011 |
| Impact des réarrangements des gènes EVI1 et PRDM16 sur les caractéristiques clinico-morphologiques et pronostiques des leucémies aiguës myéloblastiques | Recherche fondamentale | Marion Eveillard | CHU de Nantes | | 2011 |
| Mise en place du contrôle terminal des préparations d’anticancéreux injectables par spectrométrie UV-visible-IRTF, Multispec® à l’Unité de Pharmacie Clinique et Cancérologique de l’Hôpital Bon Secours de Metz : Aspects analytiques et organisationnels. | Contrôles analytiques | Alexandra CAMUT | Université de Nancy I | Consulter la thèse | 2011 |
| ADAPTATION DE LA POSOLOGIE DES ANTI-CANCEREUX A LA FONCTION RENALE | Pharmacie Clinique Oncologique | MAI BA Cam Uyen | Université Paris XI | Consulter la thèse | 2011 |
| PREVENTION DES TOXICITES SEVERES DE LA RADIO-CHIMIOTHERAPIE DANS LES CANCERS DE LA TETE ET DU COU PAR EFFET ANTIINFLAMMATOIRE DE L’IMMUNOMODULATION NUTRITIONNELLE | Pharmacie Clinique Oncologique | Christelle MACHON | Université de Montpellier | | 2011 |
| DETERMINATION D’UN INDICATEUR D’ACTIVITE PERTINENT POUR LES PREPARATIONS EN PHARMACIE HOSPITALIERE : APPLICATION A DEUX ETABLISSEMENTS DE SANTE | Pharmacotechnie | MALBRANCHE Charlotte | Université Paris V | | 2011 |
| RÔLE DU MÉTABOLISME INTRA-TUMORAL DANS LA RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX : EXEMPLE DU RÔLE DES UDPGLUCURONOSYLTRANSFÉRASES 1A DANS LA RÉPONSE A | Recherche fondamentale | Élisa FRANTZ | Université de Toulouse | | 2011 |
| Gammapathies monoclonales en Basse-Normandie : description de la population du Registre Régional des Hémopathies Malignes de Basse-Normandie et suivi d’une cohorte du service d’Hématologie Clinique du CHU de CAEN | Pharmacoeconomie / Santé publique | Bénédikte Hébert | Université de Paris Descartes | | 2011 |
| RECONSTITUTION DES POPULATIONS LYMPHOCYTAIRES APRES GREFFE DE SANG PLACENTAIRE | Recherche fondamentale | Laurence GLASMAN | Université de Marseille | | 2011 |
| EVALUATION TRANSVERSALE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES HEMATOLOGIE – PHARMACIE DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS TRAITES PAR CHIMIOTHERAPIE ANTICANCEREUSE | Pharmacie Clinique Oncologique | Aurélie LHUILLIER | CH Laval | | 2011 |
| Mise en place d’une préparation anticipée de doses arrondies de chimiothérapies anticancéreuses | Pharmacotechnie | PHILIPPE Sandrine | Université de Caen | | 2011 |
| Mise en place d’une éducation thérapeutique des patients traités par chimiothérapie anticancéreuse à l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne. | Pharmacie Clinique Oncologique | Isabelle ALLEMAN | Université d'Aix-Marseille | Consulter la thèse | 2011 |
| "UNE PREMIERE APPROCHE DANS LA SECURISATION DU CIRCUIT DES CHIMIOTHERAPIES ANTICANCEREUSES ADMINISTREES PAR VOIE ORALE : Etude de la perception de ces thérapeutiques | Pharmacie Clinique Oncologique | Eliane ORNG | Université Lyon 1, Claude Bernard | | 2011 |
| EVALUATIONS CLINIQUE ET PHARMACO-ECONOMIQUE DE L’ASSOCIATION BEVACIZUMAB/IRINOTÉCAN DANS LA PRISE EN CHARGE DES GLIOMES MALINS | Pharmacoeconomie / Santé publique | Bich Nga PHAM | Université de Lyon | | 2011 |
| Suivi de la maladie résiduelle dans les leucémies aiguës lymphoblastiques avec réarrangement du gène MLL | Recherche fondamentale | Sophie KALTENBACH | Université de Paris 5 - René Descartes | | 2011 |
| ANALYSE MÉDICO-ÉCONOMIQUE SUR L’ANALGÉSIE CONTRÔLÉE PAR LE PATIENT DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CANCÉREUSE : COMPARAISON ENTRE LA MORPHINE ET L’OXYCODONE | Pharmacoeconomie / Santé publique | Emilie PENET | Université de Limoges | | 2011 |
| INACTIVATION PAR ARN INTERFÉRENCE DE LA SYNTHÈSE DE DEUX CYTOKINES IMPLIQUÉES DANS LA MYÉLOFIBROSE PRIMITIVE : TGF-β1 ET IL-1α | Recherche fondamentale | Solène EVRARD | Université Paris Diderot | | 2011 |
| Comparaison des techniques CLHP-UV, UV/visible-IRTF et Spectroscopie Raman, appliquées au Contrôle de Qualité Analytique Libératoire des préparations injectables en milieu de soins : application à la classe des anthracyclines en cancérologie | Contrôles analytiques | Antoine MORICEAU | Université Paris Descartes | | 2011 |
| LE RÔLE DU PHARMACIEN AU SEIN D’UNE ÉQUIPE SOIGNANTE : Mise en place et évaluation d’une activité de pharmacie clinique dans le service d’hospitalisation continue d’oncologie et d’hématologie du CHU de Brest | Pharmacie Clinique Oncologique | Charlotte TANGUY GOARIN | CHRU Brest | Consulter la thèse | 2011 |
| Etude de la régulation post-transcriptionnelle de l’expression de la petite GTPase rhoB sous UV | Recherche fondamentale | Valérie Glorian-Schmitt | Université Bordeaux II, Victor Segalen | Consulter la thèse | 2011 |